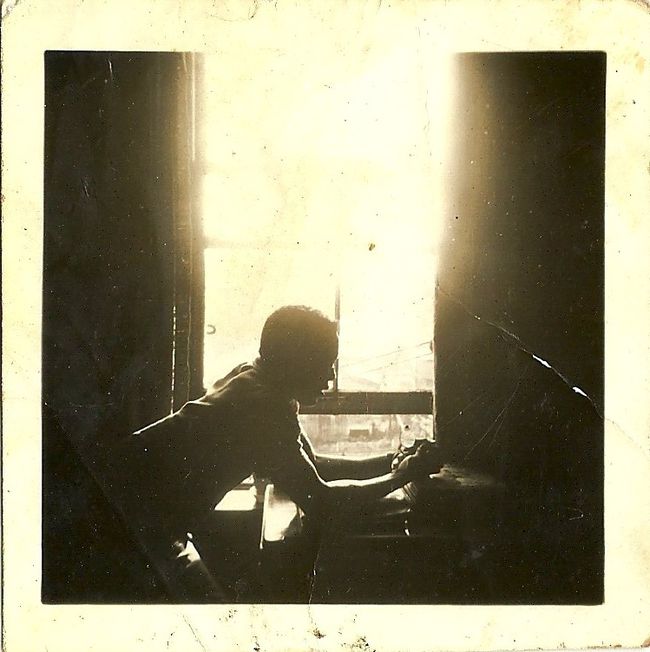Cultiver nos relations
Mae-ling Lokko et Elizabeth (Lizzie) Biney-Amissah s’intéressent à l’interconnexion entre énergie, matériaux et reconstruction communautaire
- Mae-ling Lokko
- J’ai été très heureuse de te rendre visite dans ta nouvelle maison à Nairobi. Ça m’a rappelé l’époque où tu travaillais sur les maisons de ta grand-mère au Ghana. En quoi le processus de réalisation de la maison a-t-il été différent entre Accra et Nairobi?
- Elizabeth Biney-Amissah
- Ma grand-mère m’a embarqué, il y a seize ou dix-sept ans, dans la rénovation de ses deux maisons à Accra. Au départ, je pensais que ce serait un projet simple, tranquille. C’étaient deux maisons très différentes, construites à deux moments distincts de l’histoire du Ghana : l’une, un pavillon traditionnel ancien avec des sols en terrazzo et des persiennes; l’autre, plus moderne, avec des murs et des plafonds en plâtre de Paris, des fenêtres coulissantes en aluminium et du carrelage. À l’époque, je me suis chamaillée avec ma grand-mère pour moderniser le bungalow le plus ancien, que je trouvais, visuellement, plus jolie.
Aujourd’hui, quand je rentre chez moi, je préfère rester dans la maison la plus ancienne. Elle respire. Elle a des poumons. L’air circule à travers les rainures et les languettes, et toute la surface vitrée peut être ventilée grâce aux lames de persiennes. À Nairobi, j’ai voulu vivre dans des bâtiments anciens, avec de grandes fenêtres, beaucoup de lumière et des sols durs. En vieillissant, j’ai envie de lieux qui aient une relation directe avec la lumière, l’air et l’environnement.
- MLL
- Je te comprends tout à fait. Ma famille a quitté les Philippines pour s’installer au Ghana en 2000 dans un pavillon entouré d’un immense jardin. Mon père avait conçu et construit cette maison peu à peu, dans les années 1960 ou 1970. Parrainé par le Ghana Cocoa Board, il avait obtenu une bourse pour étudier en Écosse, avant de rentrer au pays avec sa femme écossaise et ses enfants. Comme beaucoup d’hommes de sa génération, il portait en lui des mondes multiples, tant de changements culturels l’avaient traversé, chez lui et autour de lui.
En tant que chirurgien militaire à l’époque, il ajoutait un mur ou une pièce à chaque paie. Pour lui, cette maison était une façon de construire son nouveau monde et sa nouvelle vie à son retour au Ghana avec sa famille. Je ne sais pas s’il disposait de tous les outils spatiaux pour y parvenir, mais il l’a fait malgré tout. Une vingtaine d’années plus tard, nous avons décidé d’y revenir vivre. Même avec ses très belles persiennes, ses volets et sa véranda, le cœur de la maison n’était pas pensé pour une bonne ventilation transversale ni pour accueillir la lumière du jour. Depuis l’obtention de mon diplôme universitaire, j’ai passé beaucoup de temps à décloisonner et à expérimenter dans cette maison – un chantier sans fin. Construire des maisons qui favorisent la circulation de l’air n’est pas un réflexe dans nos villes africaines qui se modernisent rapidement, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. On compte sur les climatiseurs pour régler le problème. Pourtant, les maisons plus anciennes, avec leurs vérandas, leurs systèmes d’ombrage et leurs matériaux, étaient conçues pour accompagner le corps à s’adapter au fur et à mesure dans ses allers et venues, je crois que nous avons perdu cette relation. - EBA
- L’autre jour, on m’a demandé quel métier je choisirais si je pouvais retourner à l’école. Je crois que je serais architecte, avec une spécialisation en génie civil, parce que j’adore réfléchir à la façon dont les individus utilisent l’espace. J’ai grandi dans une famille qui a toujours accueilli du monde. Quand mes grands-parents vivaient dans un minuscule appartement en périphérie de Philadelphie, nous recevions tout de même une cinquantaine de personnes chaque année pour l’Action de grâce. La manière dont un espace est construit et utilisé influence notre humeur, nos interactions et qui nous sommes.
- MLL
- Ça me fait penser à l’élasticité de l’occupation des complexes résidentiels traditionnels, en fonction des personnes qui y vivent et pour combien de temps. Je me souviens avoir lu qu’au moment de la crise pétrolière de 1983, le Ghana avait anticipé l’expulsion d’un grand nombre de personnes ghanéennes. Des logements d’urgence avaient été préparés pour accueillir la main-d’œuvre ghanéenne vivant au Nigéria, mais ils sont restés vides : toute cette population a été intégrée dans le système de la maison familiale. C’était, en quelque sorte, notre forme de sécurité sociale. Je suis consciente que nos structures familiales ont changé. Beaucoup d’entre nous partent pour étudier ou travailler, et avec le coût des logements aujourd’hui, il se peut parfois que l’on revienne vivre avec sa famille. Ainsi, ce qui était autrefois une grande maison peut aujourd’hui être occupée par seulement deux parents ou grands-parents vieillissants, qui ont alors besoin de revenus. Même si nous concevons des habitations pour des familles nucléaires plus petites, la taille de cette unité familiale reste en pleine évolution. Comment concevoir des maisons qui répondent aux dynamiques spécifiques des foyers africains et à la transformation du tissu familial? De la flexibilité d’accueillir la famille élargie et des personnes invitées, mais aussi la possibilité d’en louer une partie lorsque la famille se réduit.
Quand je pense au travail que nous menons aujourd’hui sur les systèmes de matériaux architecturaux et d’énergie, je remarque que nous avons tendance à les traiter comme deux domaines séparés : l’un relevant de la conception et l’autre de la maintenance. Pourtant, ces deux dimensions sont profondément interconnectées. Vois-tu des pistes pour combler ce fossé? - EBA
- Je pense que oui. J’aime bien raconter l’histoire de la première visite de mon père ici, au Kenya. Un jour, je l’ai surpris en train de pleurer. Je lui ai demandé : « Papa, pourquoi tu pleures? » Il m’a répondu que lorsqu’il grandissait, ses points de référence étaient le Royaume-Uni ou les États-Unis. Il avait quinze ans lorsque le Ghana est devenu indépendant. Il m’a dit qu’il n’avait jamais réalisé à quel point l’Afrique pouvait être belle et qu’il aurait aimé, plus jeune, voyager à travers le continent. Je commence par cette anecdote parce que, j’ai eu l’occasion de beaucoup voyager en Afrique pour mon travail dans le développement et l’investissement énergétique. Ce que j’observe, c’est que la modernisation se fait selon des modèles occidentaux, avec des matériaux importés, pensés pour d’autres régions du monde. Pour de nombreuses personnes ghanéennes ayant vécu au Royaume-Uni, en Europe ou en Amérique du Nord, il est courant de rechercher la même esthétique, le même confort que là-bas. Nos références pour ce que nous voulons sont façonnées par nos expériences à l’étranger, et nous importons ces idées chez nous. Ainsi, beaucoup foncent chez Home Depot pour y retrouver, au Ghana, les mêmes équipements que ceux de leur maison aux États-Unis.
Après avoir construit ces maisons monstrueuses, on y installe la climatisation dans chaque pièce. On les alimente en énergie. Conçues de cette façon, les maisons sont en pratique de véritables pompes à chaleur. Et si l’on prend du recul, à l’échelle d’un quartier, on constate que ce sont les populations qui vivent dans les zones les plus défavorisées qui subissent les effets secondaires de cette chaleur et leurs conséquences délétères.
Je vois mes proches hériter de terrains légués par leurs parents, souvent occupés par d’énormes demeures. Et la première chose qui leur vient à l’esprit, c’est : comment tout raser pour y construire des appartements ou des maisons mitoyennes, optimiser au maximum la rentabilité du terrain. Ce qui est rarement pris en compte, c’est la végétation. Dans les maisons témoins des nouveaux lotissements qui se multiplient partout à Accra, on ne trouve guère plus que quelques arbustes et quelques fleurs. Il n’y a pas d’arrière-cour avec de l’herbe, pas d’arbres. Tout n’est que briques ou pavés. Il y a de l’espace, mais il est saturé de matériaux durs. J’ai l’impression que la nature est aujourd’hui considérée avant tout comme un coût d’entretien. Pas de gazon car il faut l’arroser et l’eau coûte cher. Alors, on met des pavés. Ou bien un manguier pourrait interférer avec la connexion internet ou les lignes électriques, alors on l’abat. Si on veut parler de fusionner ces silos, il faut revenir aux fondamentaux de la vie sur terre. Nous partageons cette planète avec d’autres animaux, d’autres êtres, mais nous avons adopté une attitude profondément égoïste. La mentalité dominante consiste à dire : « Je construis pour moi et les miens, peu importe les conséquences pour les autres. » À mon avis, c’est précisément ce comportement qui nous a menés là où nous en sommes.
- MLL
- C’est clairement cet état d’esprit qui règne. Ça me fait aussi penser à notre méconnaissance actuelle des rythmes saisonniers et de la terre sur laquelle nous vivons. Nous avons oublié, ou ignoré, le cheminement des rivières à travers nos paysages. Nous construisons sur leur passage, en installant des surfaces verticales imperméables comme des murs ou des chaussées, si bien que l’eau n’a nulle part où aller et s’accumule dans des zones qui fragilisent encore davantage les personnes les plus vulnérables de notre société. Pourtant, il existe des écosystèmes du sol – en déclin – composés de plantes et de champignons capables de recueillir l’eau, de la ralentir, de la stocker temporairement et même de la filtrer. Au Kenya, j’ai été profondément inspirée par la richesse de la végétation qui m’entourait et l’amélioration sensible de la qualité de vie qu’elle permet.
Selon moi, la création d’un environnement sain est indissociable de la reconstruction du tissu communautaire. Plus récemment, je me suis souvent interrogée sur le fait que je ne connais pas les personnes de mon voisinage. Si une catastrophe climatique survenait, il n’existe aucune infrastructure sociale qui nous permettrait d’y faire face ensemble. Au Ghana, les populations sont réputées pour leur sens de l’accueil. Nous avons, historiquement, des liens forts, mais ces relations se distendent ou s’étiolent au fur et à mesure des transformations des structures et des dynamiques familiales. Construire une communauté est un travail exigeant, cela demande du temps, des ressources pour s’investir de façon cohérente et réciproque. Pourtant, c’est précisément l’absence de ces liens, entre les individus et avec leur lieu, qui finit par pousser les gens à partir. Comment retisser ce tissu aujourd’hui, d’autant plus qu’il est devenu impossible pour les jeunes générations de s’offrir un logement? - EBA
- Pour faire écho à tes réflexions sur le sentiment de communauté, c’est une question que j’aborde fréquemment avec ma sœur. Elle est accompagnante à la naissance et elle parle de son travail en matière d’équité. Si elle a choisi ce métier, c’est parce qu’autrefois, au sein des communautés, nous étions entourées de grands-mères, de tantes et de toutes ces femmes qui savaient nous guider. Au fil du temps, avec les migrations, l’esclavage et le colonialisme, ce sens de la communauté à travers la diaspora s’est effiloché. Il est donc essentiel aujourd’hui de pouvoir compter sur une personne pour nous soutenir et nous défendre, que ce soit à l’hôpital ou dans d’autres contextes de soin. Je pense que ce principe résonne aussi avec mon propre travail. Je dis souvent aux gens que je suis arrivée dans le secteur de l’énergie par accident.
Au fil de mon parcours, j’ai compris que l’énergie est la pierre angulaire des économies, des pays et de presque tout. J’ai travaillé pour une entreprise appelée Nuru. Avec l’essor de l’électricité hors réseau et des énergies renouvelables décentralisées, le fondateur, Jonathan Shaw, a eu l’idée de construire un réseau métropolitain à Goma, dans l’est de la RDC. Voir cette petite ville, alimentée principalement par un réseau de 1,5 mégawatt, renforcé par d’autres réseaux plus modestes situés aux alentours, prendre vie et devenir productive, a été, pour moi, l’essence même de l’énergie.
Imaginons qu’une communauté cultive des tomates : plutôt que d’expédier des tomates fraîches au marché principal – et d’en perdre 67 % faute de stockage au froid –, elle pourrait continuer à en vendre une partie fraîche, tout en mettant une grande part en conserve et construire une usine de transformation. Cette usine permettrait de développer une activité à valeur ajoutée, conservant le produit, créant de l’emploi et devenant l’un des principaux moteurs de demande justifiant la présence du réseau énergétique pour la communauté. C’est sans doute ce qui me motive le plus à poursuivre mon travail autour de l’accès à l’énergie et de la transition énergétique. Le besoin en énergie est clair, la question est de savoir comment l’organiser et s’assurer que les gens l’utilisent.
- MLL
- La question de l’énergie est étroitement liée à celle de l’architecture, et je trouve que ton travail avec Nuru soulève des enjeux d’échelle et de temps particulièrement intéressants. On a d’un côté un acteur industriel majeur, qui consomme systématiquement une certaine quantité d’énergie à des moments précis de la journée, et plusieurs petites entités résidentielles dont la consommation d’énergie se manifeste à d’autres moments. L’industrie dispose du capital nécessaire pour financer les infrastructures de base pour un mélange composé de différents types d’énergie et de personnes qui la consomment. Au lieu de plafonner la croissance et l’accès à l’énergie, comment imaginer un mélange de sources d’énergie (renouvelables et non renouvelables) qui s’adapte aux profils variés des différents groupes consommateurs, à leurs besoins spécifiques et à leurs capacités économiques?
Goma, par son indépendance énergétique et sa productivité, est un exemple inspirant. Quand je songe à quel point nous gaspillons l’énergie aujourd’hui, c’est terrifiant. Comment pourrions-nous identifier et rationaliser ce qui requiert réellement une énergie de haute qualité – comme l’électricité – et laisser la thermodynamique s’occuper du chauffage et de la climatisation dans nos bâtiments? C’est autant de charge que nous pourrions délester de nos systèmes énergétiques.
Il s’agit en partie de mieux comprendre comment nous utilisons l’énergie : quels comportements influencent la consommation dans les villes africaines? En architecture, lorsqu’on réalise une simulation environnementale pour évaluer la gestion thermique d’un bâtiment, on s’appuie souvent sur des hypothèses standards intégrées aux modèles énergétiques. Pourtant, ces hypothèses ne correspondent pas exactement à la réalité de la consommation énergétique en Afrique. Par exemple, on n’allume pas la climatisation simplement parce qu’il fait plus d’une certaine température dehors; on la met quand des convives arrivent, pour essayer de sauver les apparences ou afficher une certaine aisance économique! La consommation d’électricité est régulée avec minutie, en fonction du coût de l’électricité. Quels sont donc ces comportements qui façonnent concrètement l’usage de l’énergie à l’échelle domestique? - EBA
- C’est une excellente question. À mesure que les marchés de l’électricité se développent, on peut espérer tendre vers un marché à grande échelle où les capacités de production les moins coûteuses et les moins impactantes sont systématiquement distribuées. Mais le plus important reste d’évoluer vers un marché au comptant qui réagit à la tarification en fonction de l’offre et de la demande. Tu as tout à fait raison de parler de la sensibilité à la tarification, quand la famille est à la maison, on s’installe sous un ventilateur, fenêtres ouvertes. Mais dès qu’une personne invitée arrive, on sort les sodas, les glaçons et on allume la climatisation. Il existe des modèles ailleurs, comme en Suède, où des dispositifs de régulation ont permis de changer les comportements. S’il s’agit simplement d’obtenir un rabais selon sa consommation, ou s’il y a des heures pleines et creuses pendant la journée, je pense que les gens adapteront leurs usages en fonction de leur budget, de leurs habitudes et de leurs besoins réels.
- MLL
- J’ai le sentiment qu’il existe de nombreux parallèles avec le secteur des matériaux de construction. Pour donner un peu de contexte : à Yale, où j’enseigne et dirige des recherches doctorales, nous avons collaboré avec une équipe de partenaires internationaux pour mieux comprendre l’empreinte carbone actuelle du secteur des matériaux de construction. Notre objectif était d’explorer à la fois la décarbonisation des matériaux conventionnels, tout en favorisant l’adoption généralisée de matériaux renouvelables à faibles émissions d’ici à 2060. Parallèlement à cette étude plus globale, nous avons mené une étude de cas centrée sur la région subsaharienne, en particulier le Ghana et le Sénégal. Ces deux pays d’Afrique de l’Ouest, bien qu’ils ne soient pas les plus vastes, connaissent un fort développement. Ils présentent des tendances clés pour les économies de taille moyenne, politiquement stables et en croissance rapide dans la région.
Dans ces deux contextes, on observe que les murs extérieurs, toutes les typologies de logement confondues, sont passés de la maçonnerie en terre à celle en béton, et que l’isolation des toitures avec de la fibre ont été remplacées par des toits en métal. Au Sénégal, où le climat est chaud et sec, de nombreux toits plats sont désormais convertis en blocs de béton. Même si des matériaux de construction de haute qualité et à faible émission de carbone sont disponibles, il reste très difficile de convaincre les populations de les adopter. Les raisons sont multiples. Certaines sont liées à la facilité d’accès et au confort d’aujourd’hui. On trouve partout des entreprises de maçonnerie qui savent travailler avec le béton et les toitures métalliques. D’autres sont liées à des souvenirs historiques relatifs à l’entretien, aux dégâts causés par l’eau et au coût. Beaucoup de nos techniques vernaculaires – comme la maçonnerie en terre ou le chaume – reposaient autrefois sur un savoir-faire exigeant, un effort collectif et un investissement en temps conséquent. Tout cela se reflète dans les coûts initiaux. Mais une fois ce problème résolu par la généralisation, la standardisation et la formation, comment étendre cette dynamique aux aspirations des populations urbaines africaines en termes de matériaux? Car les gens veulent des matériaux intéressants. On le voit dans le choix des tuiles et des façades, c’est une façon de refléter l’identité sociale. J’ai cherché à valoriser ces ambitions et ces rêves à travers la conception de nos matériaux de construction, mais il reste encore beaucoup à faire.
Tout comme ton projet à Nuru qui utilise de l’électricité hors réseau et de l’énergie renouvelable distribuée, je pense que le secteur des matériaux de construction offre une opportunité pour les matériaux renouvelables bas carbone d’être intégrés par les industries minérales et métalliques de construction établies depuis longtemps. Par exemple, les cimenteries pourraient-elles commencer à s’approvisionner en cendres volantes agricoles pour réduire la proportion de liant cimentaire nécessaire? En assurant un acheteur régulier pour les résidus agricoles, on crée les conditions pour développer les équipements, former la main-d’œuvre aux techniques durables et commencer à développer des matériaux à faible émission de carbone.
- EBA
- En vieillissant, j’ai envie de vivre dans un environnement verdoyant. Je veux pouvoir respirer un air pur, manger des fruits et des légumes frais de mon propre jardin ou d’un jardin communautaire et d’en apprécier le vrai goût. Je souhaite aussi un espace dans lequel recevoir, où les gens ont envie d’entrer. La convivialité, le lien avec les autres et la création de communauté font partie de mon ADN. J’aimerais que mes enfants grandissent dans un cadre sain, au sein d’une communauté ouverte et bienveillante.
Tu évoquais le fait de ne pas connaître ton voisinage. Il y a eu une inondation dans notre maison à Accra environ trois semaines avant mon départ pour l’école supérieure en 2015. Les murs se sont effondrés : je pouvais voir trois habitations en contrebas dans chaque direction, et l’une des maisons avait des chèvres qui sautaient par-dessus la petite barrière pour venir manger dans notre jardin. Nous avons dû discuter avec notre voisinage et partager le coût de la reconstruction. Je dirais qu’aujourd’hui les relations dans notre rue sont plus fortes, mais ma famille y vit depuis soixante ans. Il nous faut donc vivre dans un monde où l’on prend soin des autres.
Les pays du Sud sont affectés de manière disproportionnée par le changement climatique, alors même que nous n’y avons pas contribué dans sa forme actuelle. De plus, on nous demande sans cesse d’être les moteurs d’une transition énergétique avant même d’avoir pu établir des bases solides. Il faut donc que les choses soient plus équitables. Nous sommes de jeunes nations du Sud qui essaient encore de mettre en place les infrastructures fondamentales. Trouver un équilibre entre ce dont nous avons besoin, ce qui est durable et ce qui est globalement meilleur pour tout le monde doit passer par une collaboration entre les organismes de promotion immobilière, les responsables des devis, les architectes et les personnes chargées de la gestion de la municipalité ou de la ville. On ne peut y arriver qu’ensemble, mais il faut briser ces silos pour comprendre comment chaque chose influe sur les autres. Et toi, à quoi ressemblerait ton endroit idéal dans un avenir proche? - MLL
- L’époque que nous vivons aujourd’hui me donne envie de vivre au sein d’une communauté dans laquelle les personnes prennent soin des unes des autres. Je me souviens de mon père racontant son enfance à Osu, à Accra : les dîners étaient partagés avec le cousinage et le voisinage, et il y avait toujours une personne pour veiller sur les enfants dans la rue. C’est peut-être une sorte de retour vers le futur. Je pense aussi qu’il faut parler du sentiment de solitude dans les villes que ressentent beaucoup d’entre nous, partout dans le monde. Comment peut-on commencer à créer et à cultiver des relations capables de résister au temps, au climat et aux bouleversements politiques qui vont se produire encore et encore? Sur le plan physique comme sur le psychologique, j’aspire à voir une biodiversité et une tactilité des matériaux, parce que je crois qu’il existe beaucoup d’autres façons d’enrichir et d’animer nos villes. Cela doit toutefois être démocratisé, comme tu l’as souligné.
- EBA
- Tu as raison, il faut repenser la manière dont nous construisons ce monde. Nous continuons d’ériger des murs toujours plus hauts, sans même connaître les personnes qui vivent juste à côté de nous. Quand je suis arrivée au Ghana, enfant, je me souviens que notre maison était entourée de barbelés, entre lesquels se trouvaient des morceaux de verres brisés de bouteilles de soda, incrustés au sommet du mur. C’est une manière presque cynique de se protéger des personnes qui nous veulent du mal ou nous font du mal. Je pense que toutes ces choses contribuent au fait que les personnes s’éloignent de plus en plus les unes des autres et cessent de se soucier des autres.
- MLL
- Ce qui nous ramène au tissu communautaire, à ces liens et à ces moyens de communication lorsque les choses se compliquent, quand nous avons besoin d’aide, de ressources, parce qu’en fin de compte, ces situations affectent tout le monde.
- EBA
- Dans tout ce que l’on estime devoir construire, la question de l’équité doit être centrale. L’équité dans la répartition des ressources, dans l’accès aux opportunités et à tant d’autres choses. Je crois qu’il y a parfois une forme d’audace dans les faibles attentes que nous nourrissons lorsqu’il s’agit de l’accès à l’énergie. Comment peut-on sérieusement penser qu’il suffit de donner à une personne un panneau solaire pour qu’elle puisse à peine recharger une radio ou un téléphone? Todd Moss, dans son blog Eat More Electrons, parle de cette audace des faibles attentes en matière de développement et de ce que l’on accepte de construire pour les personnes situées au bas de la pyramide, comme si on leur faisait une faveur, alors qu’en réalité, le monde a plus que suffisamment de ressources et d’argent pour chaque être humain sur cette planète.1
- MLL
- Absolument. C’est là qu’intervient un paradigme bien plus libérateur en termes de conditionnement de l’espace, selon lequel la nature joue un rôle dans les villes et où l’architecture est pensée comme une forme d’infrastructure de santé publique. Plutôt que de dépendre systématiquement de la climatisation mécanique dans nos maisons ou nos bureaux, nous n’avons pas toujours besoin d’un air climatisé réglé à 17°C. Nous ne sommes pas des morceaux de viande dans un réfrigérateur, nous sommes des êtres vivants, actifs, capables de bouger, de transpirer et de réguler notre propre confort.
- EBA
- Oui, ce n’est pas nécessaire. Au Ghana, quand on demande s’il y a de la clim’ dans un Uber, on nous répond : « Tu es quoi, un poulet congelé? »
- MLL
- [Rires] Plus nous nous exposons à ces conditions pendant de longues périodes, plus notre tolérance diminue. Et ce n’est pas rendre service à notre corps. Je suis donc entièrement d’accord avec toi, il nous faut des approches bien plus imaginatives pour réfléchir à l’énergie et aux matériaux. Simplement parce que nous voulons que ces solutions émergent du monde qui nous entoure et qu’elles lui soient bénéfiques en retour.
-
Todd Moss, “The soft bigotry of low expectations,” Eat More Electrons, April 17, 2024, https://toddmoss.substack.com/p/the-soft-bigotry-of-low-expectations. ↩
Traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie.