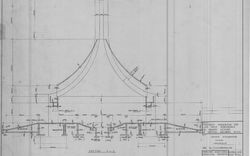Ce que nous savons
Felix McNamara écrit à Christophe Van Gerrewey au sujet de la démolition
En cogitant sur le thème de la démolition, ma réflexion s’est rapidement orientée vers un objet historique : la February House de Brooklyn Heights. Démolie en 1945 pour faire place à l’autoroute Brooklyn-Queens, cette maison eut une existence mythique (bien que de courte durée) en tant que lieu de vie d’une communauté d’artistes, notamment des figures littéraires telles que W. H. Auden. Je pensais que February House pourrait offrir une trame solide, ou servir de foyer figuratif, pour le fil de cette lettre, mais mon esprit a rapidement dérivé vers le quartier plus étendu de Brooklyn Heights, où j’ai décidé de présenter Rem Koolhaas à Norman Mailer.
Pour prendre un peu de recul, mon idée avec la February House était qu’elle puisse fonctionner comme un raccourci entre architecture et littérature (je pensais aussi à ton livre sur l’architecture de Belgique de l’année dernière qui s’ouvrait sur l’expérience négative de Baudelaire dans ce pays)1. Le style néo-Tudor de la célèbre maison faisait allusion au mépris qu’éprouvaient nombre de personnalités littéraires américaines de la seconde moitié du XXe siècle pour le modernisme architectural – ou peut-être plus précisément pour ce que Venturi appelait « l’architecture moderne traditionnelle », dans Complexity and Contradiction in Architecture2 – et son apparente colonisation de la métropole américaine d’après-guerre. J’avais en tête la critique du modernisme en 1981 par Tom Wolfe, largement décriée, From Bauhaus to Our House3, qui révélait une homologie ironique entre le modernisme le plus brutal d’alors et le postmodernisme le plus abrupt de notre présent récent. Dans les deux cas, les critiques prétendument formelles masquent souvent des motivations essentiellement économiques, comme en témoigne un article rédigé par un ancien politicien et esthète influent4 du pays d’où j’écris, qui estime que le moderne comme le postmoderne5 méritent la démolition.
Dans le New York Times, Paul Goldberger écrit à propos du livre de Wolfe sur le Bauhaus :
Je crois que le problème – et nous touchons ici à l’essence même de ce qui ne va pas dans ce livre – est que Tom Wolfe ne voit pas. Il a une oreille fine, attentive et soutenue, mais il ne semble pas savoir regarder. Il ne voit pas, pour ne prendre qu’un exemple parmi tant d’autres, que le Seagram Building de Mies van der Rohe est un objet somptueux, d’une beauté extraordinaire. Il ne le considère qu’à travers la théorisation de Mies van der Rohe, autrement dit comme le prototype d’un style architectural universel, et non comme une œuvre d’art singulière, et même complexe.6
Tandis que Goldberger condamne les lacunes oculaires de Wolfe, Robert Hughes écrit, dans une critique de The Painted Word7, la charge satirique contre le monde de « l’art moderne », aujourd’hui dépassé, publiée en 1975 :
Wolfe a l’œil aiguisé dès qu’il s’agit de ce qu’il connaît, à savoir les prétentions de la clientèle de l’art et les stratagèmes par lesquels le gratin new-yorkais instrumentalise l’art contemporain comme un outil d’ascension sociale. Il se retrouve donc en terrain connu, faisant partie intégrante de son sujet d’étude, frivole et soumis aux diktats de la mode. Il y était. Mais il n’était dans aucun des lieux où l’art se créait, ni là où il faisait l’objet d’une réflexion sérieuse.8
Le compliment de Goldberger sur la capacité de Wolfe à écouter les idées et les théories n’est pas partagé par Hughes, qui estime que l’auteur semble « ne rien savoir de l’histoire de l’art, qu’elle soit américaine ou européenne ». La popularité de Wolfe en tant que punching-ball – peut-être une extension inévitable de sa popularité tout court – a bien sûr été savourée par Norman Mailer, résident de Brooklyn Heights. Dans sa critique d’A Man in Full9 paru en 1998, dans New York Review of Books, Mailer formule une pique relativement polie :
Écrire un best-seller dans l’intention délibérée d’en faire un, c’est, après tout, un état d’esprit similaire à celui de se marier pour des raisons pécuniaires, pour ensuite découvrir que l’absence d’amour est plus onéreuse que prévu.10
Ce qui m’intéresse ici, c’est que Mailer partageait avec Wolfe un mépris pour « l’architecture moderne » (en gros). Mais là où Wolf, fut simplement (voire totalement) ridiculisé pour ses interventions jugées triviales dans des disciplines ou des formes artistiques dont on disait qu’il n’avait pas une connaissance suffisante, Mailer a sans doute fait une intervention encore plus éloignée, non pas dans un domaine intellectuel ou créatif étranger au sien, mais dans la politique. Son « art outsider », la campagne électorale pour la mairie de New York en 1969 (Mailer-Breslin), me semble, à la fois, koolhaasien et, étrangement pertinent d’un point de vue thématique pour l’exposition et le film du CCA, Bâtir des lois. Un article de Dezeen sur l’exposition de Koolhaas à la biennale de Venise en 2014, cite l’architecte :
…l’exposition Elements s’intéresse à des composants architecturaux tels que les ascenseurs et les escaliers mécaniques, qui « n’ont jamais vraiment été intégrés à l’idéologie ou à la théorie de l’architecture »…11
Koolhaas lui-même avait déjà introduit les ascenseurs dans l’idéologie et/ou la théorie de l’architecture dans Delirious New York12 (1978). Dix ans plus tôt, Mailer avait fait de même lors de sa campagne municipale : la politique qu’il proposait, les « Sweet Sundays », visait à instaurer un jour par mois sans aucun moyen de transport mécanisé, y compris les ascenseurs. Dans un entretien mené à l’EPFL en 2019 à propos de ton travail sur Koolhaas/OMA, tu affirmes, en parlant de l’héritage de l’architecte aujourd’hui :
D’une part, il a contribué à élargir le champ de l’architecture à l’échelle mondiale, en montrant qu’elle pouvait être plaisante et amusante. D’autre part, tout ce qu’il a défendu et incarné est désormais condamné et considéré comme problématique.13
À propos de cette ligne que je trace entre Koolhaas et Mailer, l’ironie réside dans le fait que, si ce dernier a longtemps été condamné comme un personnage problématique, l’environnementalisme expérimental de sa campagne municipale anticipe étonnamment certains des projets de conception que l’on demande aujourd’hui aux personnes qui étudient l’architecture contemporaine. Il proposait de bannir toutes les voitures privées à Manhattan (tout en séparant la ville de New York de l’État de New York pour lui accorder un statut étatique, et en transformant Coney Island en une sorte de région administrative spéciale Macaoesque pour augmenter les recettes fiscales grâce aux jeux d’argent). Le New York de Mailer, ou les visions qu’il en avait, étaient tout aussi délirant que celui imaginé par Koolhaas à la fin des années 1970, à ceci près que tout ce que les Mailer et les Wolf jugeaient aliénant dans l’architecture moderne, Koolhaas, lui, le célébrait. L’article-entretien de l’EPFL mentionné plus haut s’ouvre sur cette remarque :
« Je me considère comme un descendant des véritables modernistes », déclarait le jeune Rem Koolhaas dans le journal néerlandais wonen-TA/BK en 1978. Il ajoutait ne pas s’inquiéter du fait que son approche utilitaire de l’architecture n’était pas dans l’air de son temps.14
Les conférences, séminaires, documentaires, etc. sur l’œuvre de Koolhaas s’ouvrent généralement par le fait que l’architecte a débuté sa vie créative adulte comme scénariste. Il est un écrivain-architecte, tout comme Mailer fut (brièvement) un écrivain-politicien. Dans les deux cas, le préfixe écrivain semble avoir été adopté avec quelques libertés, sans doute celles accordées par la confiance en soi masculine.
En réfléchissant aux exemples que j’ai présentés plus haut, je suis parvenu à un principe commun : les écrivains, d’une manière générale, ont tendance à être des dilettantes intellectuels/ des extrêmes généralistes. La forme de l’écriture, c’est l’écriture même. Mais son contenu – qu’il s’agisse de non-fiction ou de fiction – peut être, et est censé être, littéralement n’importe quoi; sans bornes. Même si l’on s’égare en territoire inconnu comme Tom Wolfe, on finit toujours par retomber sur ses pieds, on peut s’abriter derrière le confort de la forme écrite, le réconfort du style. Ce qui m’a conduit à m’interroger si les architectes deviennent, à leur tour, plus semblables aux personnalités écrivaines, dans cette disposition au dilettantisme? Est-ce une façon de se frayer un chemin, à la Tom Wolfe, à travers des domaines qu’on ne maîtrise pas, ou est-ce une manière de faire bon usage de ce généralisme propre à l’écriture? Le problème ici, c’est que les architectes font face à une situation bien plus complexe que leurs homologues littéraires, qui disposent de champs illimités quant au contenu, quoique dans le cadre des paramètres formels précis du langage écrit. Les architectes d’aujourd’hui doivent réinventer à la fois leur forme et composer avec d’infinies variables de contenu. Dans les écoles d’architecture actuelles, les consignes des projets demandés s’articulent souvent autour de a) un contenu où l’humanité est en proie à des apocalypses x/y/z; et b) d’une forme qui engage une technologie ou un paradigme spatial encore inexistants. En général, le semestre ne suffit pas à proposer grand-chose de très pertinent. C’est peut-être pour cela que Koolhaas, jeune écrivain en transition vers l’architecture, voyait dans le « vrai modernisme » une piste à suivre : le modernisme fut confronté à l’expansion massive du contenu médiatisé par de nouveaux genres et échelles de type de construction, mais dans un cadre formel dans lequel la forme de l’architecture était la construction. Le roman moderniste pouvait tout absorber comme contenu, mais savait que sa forme resterait celle de mots sur des pages.
Étant donné que « …l’industrie de la construction représente au moins 38 % des émissions de carbone dans le monde », l’exposition et le film Bâtir des lois s’intéressent aux « architectes d’aujourd’hui qui cultivent des modes de pratique alternatifs ». Cette dynamique, passionnante à bien des égards, vécue, je crois, à l’échelle mondiale, semble dessiner une bifurcation : décentrer la construction de bâtiments de la pratique architecturale, ou redoubler d’efforts dans la composition de bâtiments avec un grand B. Les deux voies seront inévitablement empruntées en parallèle, et elles pourraient converger plus fréquemment que les sectaires les plus doctrinaires de l’un ou l’autre camp ne l’admettraient (après tout, OMA et AMO fonctionnent en miroir). Cela soulève une question intéressante : quelle est, ou quelle sera, la nature de l’architecture – ou de la forme architecturale – dans le siècle à venir, et au-delà? Là encore, la littérature ne semble jamais avoir été confrontée à une telle remise en question : même lorsque Mallarmé a poussé à l’extrême la nature graphique du texte, cela n’a guère abouti à une négation de l’écriture en tant que forme. La littérature n’est donc probablement pas un analogue pertinent pour la crise d’identité formelle que traverse l’architecture. Et pourtant, Keller Easterling invoque Victor Hugo pour cartographier l’évolution d’une architecture non construite.15 La quête eisenmanienne d’un langage architectural paraît se poursuivre, même si Eisenman lui-même soit en désaccord avec le zeitgeist général des institutions contemporaines architecturales16 – ce qui explique peut-être, en partie, pourquoi lui et Elisa Iturbe ont coécrit un ouvrage sur les raisons pour lesquelles il est tendance d’être « en retard »17.
Si la « démolition » opère ici, en fin de compte, comme une métaphore dans cette lettre, c’est sans doute celle potentielle des frontières entre ce que les architectes peuvent et ne peuvent pas – ou devraient et ne devraient pas – faire. Je ne sais pas si les architectes de notre époque ont véritablement quelque chose à apprendre de la communauté écrivaine, mais j’aimerais beaucoup lire tes réflexions à ce sujet.
-
Christophe van Gerreway, Something Completely Different: Architecture in Belgium (MIT Press, 2024). ↩
-
Publié en français sous le titre De l’ambiguïté en architecture, Paris, Dunot, 1976. ↩
-
Publié en français sous le titre Il court, il court le Bauhaus, Paris, Les Belles Lettres, 2012. ↩
-
Jack Mahony, « NSW Premier Dominic Perrottet treats fans to special performance of Bon Jovi’s ‘Livin’ on a Prayer’ on live radio », SkyNews, 14 juillet 2022, https://www.skynews.com.au/lifestyle/trending/nsw-premier-dominic-perrottet-treats-fans-to-special-performance-of-bon-jovis-livin-on-a-prayer-on-live-radio/news-story/a2224871f5477ac98dbc5a980c9b00ea. ↩
-
Dominic Perrottet, « Ten iconic buildings I’d bulldoze, by Treasurer Dominic Perrottet », The Sydney Morning Herald, 24 novembre 2020, https://www.smh.com.au/politics/nsw/ten-iconic-buildings-i-d-bulldoze-by-treasurer-dominic-perrottet-20201124-p56hc5.html. ↩
-
Paul Goldberger, “From Bauhaus to Our House,” The New York Times, 11 October 1981 ↩
-
Publié en français sous le titre Le Mot peint, Paris, Gallimard, 1977. ↩
-
Robert Hughes, “Art: Lost in Culture Gulch,” Time Magazine, 23 June 1975 ↩
-
Publié en français sous le titre Un homme, un vrai, Paris, Robert Laffont, 1999. ↩
-
Norman Mailer, “A Man Half Full,” The New York Review of Books, 17 decembre 1998 ↩
-
Benedict Hobson, “Rem Koolhaas’ Elements exhibition in Venice aims to ‘modernise architectural thinking,’” Dezeen, 6 juin 2014, https://www.dezeen.com/2014/06/06/rem-koolhaas-elements-of-architecture-exhibition-movie-venice-biennale-2014/. ↩
-
En français sous le titre New York délire, Paris, Chêne, 1978. ↩
-
Christophe van Gerrewey, “A new anthology highlights the legacy of Rem Koolhaas,” entretien par Sandrine Perroud, News, EPFL, 8 octobre 2019, https://actu.epfl.ch/news/a-new-anthology-highlights-the-legacy-of-rem-koo-2/. ↩
-
van Gerrewey, entretien. ↩
-
Keller Easterling, The Action is the Form: Victor Hugo’s TED Talk (Strelka Press, 2012) ↩
-
Robert Locke, “Peter Eisenman: ‘Liberal Views Have Never Built Anything of any Value.’” Archinect, 27 juillet 2004, https://archinect.com/features/article/4618/peter-eisenman-liberal-views-have-never-built-anything-of-any-value. ↩
-
Peter Eisenman et Elisa Iturbe, Lateness (Princeton University Press, 2020). ↩
Texte traduit de l’anglais par Gauthier Lesturgie