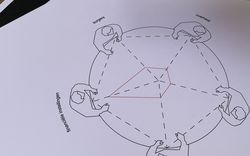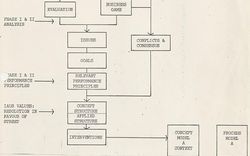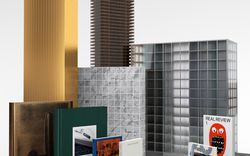Le complexe du contexte
Andrew Scheinman contextualise un mot important
Le mot « contexte », en architecture, a toujours été quelque peu dénué de sens. Utilisé seul, il est malléable, un signifiant vide – il porte le poids discursif que les architectes lui assignent. Le contexte peut suggérer les conditions d’un site, le cadre topographique, géographique ou écologique dont un bâtiment est censé être issu. Il peut aussi, ou plutôt pourrait, renvoyer à un ensemble de conditions sociales dépendantes de l’histoire, de la mémoire, de la culture, ou de toute une série de mots creux eux-mêmes lexicalement ambigus. Le contexte peut dénoter le tissu urbain existant, la texture poétique d’une ville ou d’un paysage. Il peut référer à un style architectural prescriptif et détaillé, ou peut-être à une acceptation pluraliste de quelques styles contradictoires ou anachroniques. Il pourrait aussi faire fi de toute préoccupation physique, sociale et stylistique, échappant même à la clarté lorsqu’il est générique. Le mot pourrait juste saisir une expérience sensorielle ou phénoménologique : l’aspect d’un lieu, sa sonorité, sa sensation, son odeur et, bien sûr, son goût1. La seule chose que ce mot banal et dissyllabique désigne systématiquement est une chose, n’importe quoi en fait, à laquelle un architecte doit prêter attention dans le processus de conception et qui n’est clairement pas le projet en question. Relationnel par nature, le mot « contexte » ne signifie rien – c’est-à-dire que ce qu’il décrit n’est pas contextuellement relié à quelque chose en particulier – jusqu’à ce qu’un architecte l’appelle par son nom. Le contexte est précisément, intrinsèquement négatif – un ensemble lacunaire qui attend, dès le moment où il est défini comme tel, un bâtiment jusqu’ici manquant.
Pourtant, le mot et son kaléidoscope d’usages ont été la pierre angulaire de l’architecture, de l’urbanisme et de l’affrontement de ces deux programmes pendant près d’un siècle. En dépit (ou peut-être à cause) de la définition disciplinaire déroutante assignée au mot « contexte », des générations de nombrilistes ont passé leur carrière à faire couler de l’encre pour l’épingler. La revue Oppositions, lancée à l’apogée du postmodernisme américain par certains de ses représentants les plus influents, a mis sur la sellette la discipline même en réfutant le postulat d’une architecture contextuelle, ou du moins en s’interrogeant sur l’attention que les architectes devraient lui prêter concrètement2. Plus tard, en 1992, un numéro de Lotus consacré en partie au contextualisme a riposté, arrivant à la conclusion qu’en effet, le contexte demeure crucial et que les architectes et les théoriciens devraient certainement continuer à l’analyser3. De toute évidence, c’est le point de vue d’Oppositions qui l’a emporté : juste après que Lotus ait lutté pour la pérennité du mot, le zeitgeist l’a largement laissé tomber, du moins dans son usage. Trois ans plus tard, Rem Koolhaas, à son tour, a parfaitement résumé ce rejet en parlant d’un « contexte de merde4 », et dans les deux décennies qui ont suivi, le mot ainsi que le débat qu’il suscite ont largement disparu du discours, comme le documente bien l’historien de l’architecture Esin Kömez Dağlıoğlu. Récemment, cependant, une vague tranquille de nouvelles publications et de pratiques à petite échelle qui réfutent ce rejet a ressuscité le programme contextualiste, en utilisant parfois l’un des nombreux synonymes proposés, tels que « champ », « site » et « instauration5 ». La signification que prend le mot contexte ces temps-ci pourrait en dire plus sur les identités particulières des architectes faisant référence au contexte que sur toute nouvelle condition en elle-même.
Le contextualisme, en tant que stratégie de conception, n’a rien de nouveau aujourd’hui : depuis des siècles, des traités se penchent sur le concept, si ce n’est toujours mot à mot, du moins en esprit. Une itération moderne du mot est apparue avec le decorum de la Renaissance, désignant une continuité visuelle entre le site et le bâtiment fondée sur l’utilisation des matériaux et de l’ornementation6. Puis, il y a eu le genius loci, ou « esprit du lieu », réemprunté à la religion romaine classique par le poète anglais du XVIIIe siècle Alexandre Pope dans une lettre sur la conception des jardins. Invoquant ce que l’Antiquité percevait comme un esprit littéral – un animal surnaturel, un elfe ou une fée jouant le rôle de veilleur ou de gardien local –, Pope conseillait aux concepteurs de « consulter le génie du lieu en tout », affirmant la qualité mystique et impénétrable du contexte dans l’architecture.
Le mot « contexte » lui-même n’est apparu que beaucoup plus tard, avec Robert Venturi qui, dans son mémoire de maîtrise, a déclaré en 1950, de manière détournée, qu’ « il faudrait respecter les conditions existantes autour du site qui devraient faire partie de tout problème de conception ». En résumé, le contexte « est ce qui donne son sens à un bâtiment7 ». Développant cette thèse dans son ouvrage Complexity and Contradiction in Architecture paru en 1966, Venturi y suggère que les nouveaux bâtiments ne sont que des morceaux d’un tissu urbain composite – de simples fragments d’un « ensemble difficile » – et devraient être conçus comme tels. Leur forme et leur position devraient, en mariant le neuf et l’ancien, refléter une modestie qui manque cruellement à l’architecture moderne de son temps8.
De fait, Venturi se servait ici du mot de façon réactionnaire, s’inscrivant dans la critique générationnelle du modernisme qui allait devenir le postmodernisme. À l’époque de ses études de troisième cycle à Princeton, la tabula rasa moderniste était le paradigme dominant dans l’enseignement de l’architecture occidental. Les architectes étaient supposés aplatir le paysage, la culture et la vie sociale sous une couverture de fonction et de forme universalisantes, inaugurant une ère utopique par la force de la volonté, de la bienveillance et de l’expertise. Le design, à son tour, devait se dépouiller de toute ornementation, en ne s’appuyant que sur la représentation de « vérités éternelles » supposément communes à toute l’humanité, en dépit de la spécificité des sites. Dans le style international consacré par le Museum of Modern Art de New York en 19329, les bâtiments seraient totalement indépendants du terrain sur lequel ils prenaient forme, n’exprimant que l’ère de la machine. Cette révolution esthétique, et elle uniquement, devait, selon les modernistes engagés, libérer les classes inférieures des âpres cordons de la misère, leurs architectures inadaptées les condamnant au statu quo social. Les conditions existantes n’étaient guère plus que des obstacles au progrès social – quelque chose que l’architecte visionnaire devrait abolir, à regret même le cas échéant, dans le processus inévitablement associé à ce que le géographe et théoricien urbain David Harvey appelle la « destruction créative10 ».
Denise Scott Brown développera plus tard le regard critique jeté par son associé Venturi sur le néologisme architectural : par sa définition même, le « con-texte », implique un « texte » en son centre. Ce qui entoure ce texte est moins agentiel qu’inerte ou passif11. Seul l’architecte, selon le mouvement moderniste, fournirait le texte; le contexte n’était qu’une toile de fond, la mise en scène de l’acte héroïque de conception12.
Au terme de deux guerres mondiales, cependant – donc après Hiroshima et Auschwitz, ces deux grands événements qui ont sonné le glas de la libération technologique –, le monde occidental avait connu assez de destruction créative. Stimulé par l’hégémonie économique et culturelle des États-Unis, l’Occident de l’après-guerre a fondé sa stabilité sur des solutions capitalistes et, à leur tour, les modernistes nord-américains ont commencé à vider leurs projets de la plupart des idéaux émancipateurs. Les arêtes élancées et les espaces libres de leurs bâtiments, jadis parangons de la révolution par l’architecture, passaient de plus en plus aux yeux des critiques pour de simples symboles de la prospérité et de l’habillage des vitrines du pouvoir au service du statu quo. Au milieu des années 1960, les concepteurs modernistes ont été sévèrement critiqués, comme Harvey le résumera plus tard, pour leur tendance à construire des « images impeccables de pouvoir et de prestige pour les entreprises et les gouvernements soucieux de publicité » et à produire, à travers des projets de logements comme celui de Pruitt-Igoe à St. Louis, des « symboles d’aliénation et de déshumanisation13 ». Jane Jacobs, pour sa part, a épinglé un certain nombre de projets créatifs destructeurs comme étant, même dans le meilleur des cas, présomptueux, trop simplifiés et détachés de la diversité et de la complexité de la vie urbaine14. De manière plus subtile, peut-être, Bernard Rudofsky a fourni à la discipline architecturale elle-même une alternative à ses excès. À l’occasion d’une exposition exceptionnelle en 1964 au Museum of Modern Art, Rudofsky a invité son public, une cohorte d’experts new-yorkais, à opter pour l’humilité d’une « architecture sans architecte », « sans pedigree » et vernaculaire, ajoutant d’un air faussement pudique que les constructeurs anonymes, contrairement aux professionnels, « subordonnent rarement le bien-être général à la poursuite du profit et du progrès15 ».
Ainsi, pour Venturi et Scott Brown, prêter attention au contexte d’un site était une sorte de modestie milieu de siècle – la fin de l’héroïsme rassis, servile et complet du modernisme et l’amorce d’une sorte de révolution plus démocratique. Ou, du moins, c’en était la promesse. En effet, ce que Venturi et Scott Brown ont cherché à apprendre à travers l’étude marquante qu’ils consacrent à Las Vegas en 1968 n’était rien de moins qu’ « une nouvelle réceptivité aux goûts et aux valeurs des autres et une nouvelle modestie dans nos conceptions et dans notre perception du rôle de l’architecte dans la société16 ». La manière de procéder, pour Venturi et Scott Brown, consistait à observer et à exalter un langage visuel bien compris par les Américains ordinaires – le langage commercial vernaculaire de la culture pop et du consumérisme –, puis à reproduire ses signes et symboles, dans son propre langage, sous forme de façades. Leur travail d’architectes, prétendaient-ils, revenait moins à amender la rudesse de la culture, comme le voulaient leurs prédécesseurs modernistes, qu’à repenser la construction spatiale pour l’accommoder.
Comme Venturi et Scott Brown, Colin Rowe a cherché un remède contextuel à l’orgueil professionnel, mais a centré sa définition du mot sur une « texture » urbaine plus formelle, qualifiant son approche de contextualisme. Dénigrant la tendance moderniste à concevoir avec ce qu’il considère comme une rigidité totalitaire, Rowe a proposé un compromis entre la ville moderne et la ville traditionnelle - un « centre radical » entre le nouveau et « le contexte connu, peut-être banal et, nécessairement, chargé de mémoire, d’où il émerge17 ». Répondre au contexte, c’était moins s’accommoder de la culture de masse selon ses propres termes que d’accepter l’éclectisme, la fragmentation et l’hétérogénéité des formes que les tissus urbains accumulent au fil du temps et de le réinterpréter dans des ensembles réactifs. Plutôt que de raser ou d’aplatir ce qui existe déjà, Rowe soutenait que l’architecte devrait respecter les réponses intuitives des constructeurs traditionnels à leur contexte en remplissant, complétant ou soustrayant des éléments de leur travail. C’était son contexte formel, une série de types urbains que l’on trouve dans la ville et qui sont ensuite assemblés à nouveau comme des bâtiments composites.
En Europe, par contre, le modernisme et ses suites se sont déroulés un peu différemment. Les villes du continent avaient été démolies par la guerre, relancées par ce qu’on appelle des miracles économiques et, au milieu du siècle, elles avaient un besoin urgent de se reconstituer. Cela a laissé beaucoup de place pour des programmes de restauration et de rénovation, mais surtout, cela a laissé les villes avec le désir, au nom de la continuité culturelle, de reconstituer leur tissu urbain d’avant-guerre. Le renouveau historique était donc monnaie courante dans les années 1950, moins par la réutilisation des symboles ou des types qu’il allait devenir en Amérique du Nord que par la restitution intégrale des styles de construction traditionnels. Ernesto N. Rogers, rédacteur de Casabella de 1953 à 1965, trouve cette architecture impuissante, et dans son premier éditorial, s’attaque à la fois à ce « folklorisme démagogique » et à la rupture moderniste avec l’histoire à laquelle il s’oppose18. Ces deux programmes, selon lui, étaient obsolètes et régressifs : ni les traditions profondément enracinées de sa patrie italienne ni la révolution en cours du modernisme ne pouvaient bien s’exprimer par une réduction de l’architecture à la seule forme. Les architectes devraient plutôt faire la cour à l’ambiance de leur site - les expériences culturelles cumulées de la ville, qui, bien que de nature éphémère, se manifestent sur des décennies par une conception fragmentaire. Le contexte, pour Rogers, était de cette façon phénoménologique à la base. Et c’est cette facette phénoménologique du concept que son étudiant Aldo Rossi a poursuivi et développé, en s’inspirant également du genius loci romain, en introduisant son néologisme locus dans son L’architettura della città de 1966. Tout comme l’esprit protecteur divin, locus, tel que Rossi l’a défini, est quelque chose de local et de vivant - une alternative éphémère à la stérile « mise en scène » que la notion statique de contexte demande aux architectes. En termes simples, il s’agit « d’une relation entre un certain lieu spécifique et les bâtiments qui s’y trouvent19 ». En ce qui concerne le mot contexte, locus est moins axé sur l’objet et plus dynamique, englobant la notion même de texte.
Bien que Venturi et Scott Brown, Rowe et Rossi se soient souvent contredits l’un l’autre – comme le note Kömez Dağlıoğlu, à l’origine le débat sur le contexte était en effet multiphonique20–, leurs critiques permanentes du modernisme en sont venues à ne faire qu’une à l’occasion de deux expositions marquantes en Italie, en 1978 et en 1980. Les pratiques susmentionnées et leurs versions du contexte sont apparues côte à côte, d’abord à Roma Interrotta, qui a invité douze architectes à réimaginer le développement urbain d’une Rome « interrompue », puis une nouvelle fois deux ans plus tard, à la première Biennale d’architecture de Venise, intitulée La présence du passé. En dépit de la diversité sous-jacente exposée, dans la Strada Novissima par exemple qui montrait une rue bordée d’un strict alignement de vingt façades d’architectes différents, c’est la coalescence même des approches contextualistes qui a prédit le coup de grâce du concept21. Au cours de la décennie précédant ces expositions, les critiques de l’esthétique postmoderne, dont beaucoup étaient restées fidèles à la promesse émancipatrice du modernisme, ont de plus en plus considéré le contextualisme comme une valorisation visuelle de la production capitaliste. Pour cette frange de l’opposition – menée par un groupe d’« architectes critiques » écrivant dans Oppositions –, le contextualisme n’était guère plus qu’un façadisme ironique : au mieux, son architecture répondait effectivement à l’esprit du lieu; mais le plus souvent, il se manifestait sous la forme d’un pastiche qui, comme le pire du modernisme avant lui, recouvrait simplement un statu quo oppressif par des hochements de tête visuels ineptes. Dans la maigre scénographie des deux expositions – qui, en tant que lieux de mise en scène de par leur nature même, n’ont pas favorisé les contextualistes – a fourni une bonne cible aux critiques. Posant un geste d’éclat, Kenneth Frampton, alors rédacteur en chef d’Oppositions, a démissionné de l’équipe de conservateurs de la Biennale, étant en total désaccord avec la sélection d’exposants américains dont l’adhésion au populisme, craignait-il, légitimerait l’amalgame de la culture de masse avec la machinerie marchande du capitalisme libéral22.
Appelant au changement, les critiques ont proposé des alternatives aux approches architecturales exposées à Rome et à Venise. Frampton, par exemple, a suggéré de renoncer à des « tentatives simplistes de ressusciter les formes hypothétiques d’un langage vernaculaire perdu » au profit d’une architecture qui réponde à une compréhension plus tactile du contexte, c’est-à-dire à la topographie, au climat, à la lumière et à la forme tectonique23. Peter Eisenman, un autre rédacteur en chef d’Oppositions, est allé plus loin, en plaidant pour une « autonomie » architecturale fondée dans l’ensemble sur l’ignorance délibérée des conditions existantes24. K. Michael Hays a adopté une position intermédiaire, entre une architecture contextuelle qui « reconfirme l’hégémonie de la culture et contribue à assurer sa continuité » et une architecture autonome qui, réduite à une forme pure, « s’est désarmée dès le départ, conservant sa pureté en accédant à l’inefficacité sociale et politique25 ». En 1988, la critique se faisait concise : pour Mark Wigley et Philip Johnson, conservateurs de l’exposition Architecture déconstructiviste au Museum of Modern Art, « le contextualisme a souvent servi d’ « excuse pour la médiocrité, pour une servilité muette envers le familier26 ». Ce qu’ils ont proposé à la place était moins un mouvement qu’une collection d’architectes, notamment Koolhaas et Eisenman, qui ont incarné l’autonomie et embrassé la cause, non pas du contexte, mais du recentrage du bâtiment lui-même. Le texte, en termes simples, serait une fois de plus fourni par l’architecte, de crainte que l’hégémonie capitaliste ne trouve son champion dans un vernaculaire fictif et fabriqué.
Ce qui s’est passé, cependant, au cours de ces deux dernières décennies sans débat sur le contexte, c’est que l’hégémonie capitaliste a de toute façon trouvé son champion chez les architectes eux-mêmes. Avec tout le poids concentré sur la paternité d’un ouvrage, l’autonomie reposait sur la bonne foi de ses auteurs pour résister aux forces économiques, une bonne foi qui s’est rapidement effacée, car la critique qu’elle exigeait s’est faite de plus en plus obsolète, non pertinente, et codée27. L’autonomie, opposée au contextualisme par nature, a été écartée au profit de l’instrumentalité, un changement de paradigme personnifié par Koolhaas : « Certains de nos engagements les plus intéressants sont peut-être des engagements sans critique, emphatiques, qui traitent de la difficulté parfois insensée d’un projet architectural à faire face à l’incroyable accumulation de questions économiques, culturelles, politiques mais aussi logistiques28 ». Le contexte faisait désormais partie de la conversation, mais sans porter son nom, compris uniquement comme un ensemble de problèmes à surmonter par un professionnel. En produisant des « objets autonomes standardisés » avec une incapacité prononcée et reconnue à effectuer tout changement social durable, des architectes comme Koolhaas ont depuis appris à « ignorer les préoccupations contextuelles, puisque le but de leur pragmatisme est de leur permettre d’opérer sur différents territoires dans des régimes politiques et des conditions sociales contradictoires29 ».
Alors que des architectes s’efforcent aujourd’hui d’intégrer à nouveau des programmes contextualistes, il semble utile d’aborder la seule chose que le mouvement du XXe siècle n’a jamais vraiment abordée : c’est-à-dire ce qui définit la discipline elle-même. Il est clair que le contexte, le concept étiqueté comme tel par les architectes dans le processus de conception, reconnaît la différence et ramène l’orgueil démesuré des designers à la réalité plus humble des chercheurs bien intentionnés. Mais il le fait sans admettre qu’il s’agit d’une ombre portée par les professionnels, un groupe défini par les mêmes cadres et hiérarchies sociaux, économiques et politiques que les contextes qu’il étudie. En effet, comme l’a récemment fait remarquer Bryony Roberts, « les corps portent des histoires, volontairement ou non. Tout observateur supposé impartial est empêtré dans les préjugés culturels et les luttes politiques de son contexte30. » Le mot contexte, qui n’est rien d’autre qu’un vernis pour l’entreprise souvent discutable qu’est l’architecture, ignore le contexte de sa propre fabrication. Mais si les architectes le font volontairement s’effondrer dans son équivalent, le texte - s’ils remettent en question l’entreprise de l’architecture à côté de l’architecture elle-même - alors la galerie des glaces se brise. Ce qui reste du contexte, lorsqu’il est contextualisé, n’est que le sens le plus large et le plus fondamental du mot : c’est la structure complexe qui remet l’architecture, en tant que discipline, à sa place.
-
Pour en savoir plus sur l’utilisation imprécise du mot en architecture, voir Sandy Isenstadt, « Contested Contexts », dans Site Matters: Design Concepts, Histories and Strategies, sous la dir. de Carol Burns et Andrea Kahn, Routledge, London, 2005, 157–159. ↩
-
La revue Oppositions, publiée de 1973 à 1984 par l’Institute for Architecture and Urban Studies, s’intéressait principalement, comme l’écrit K. Michael Hays, « aux contradictions essentielles entre l’autonomie - son auto-organisation en un ensemble d’éléments formels et d’opérations qui la séparent de tout lieu et temps particulier - et sa subordination à des forces historiques échappant à son contrôle, voire sa détermination par celles-ci ». En résumant la position éditoriale de la revue, Hays élude la question de savoir s’il faut ou non s’occuper de ces forces incontrôlables, et suggère plutôt que « l’on ne devrait pas se demander si l’architecture est autonome, ou si elle peut délibérément l’être, mais plutôt comment il se fait que la question se pose en premier lieu, quel type de situation permet à l’architecture de s’inquiéter d’elle-même à ce degré ». K. Michael Hays, « The Oppositions of Autonomy and History », in Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, dir. K. Michael Hays, Princeton Architectural Press, New York, 1998, ix. ↩
-
Lotus 74, La memoria dell’architetto/The Memory of the Architect (Novembre 1992). ↩
-
Bien que ce soit loin d’être un véritable mantra architectural. Plus précisément, cette citation reflète l’antagonisme que Koolhaas voyait à l’époque entre le grand et le petit dans la ville, une opposition entre l’architecture et l’urbanisme : « Ensemble, toutes ces ruptures [architecturales-historiques] d’échelle, de composition architecturale, de tradition, de transparence, d’éthique, impliquent la rupture finale, la plus radicale : la grandeur ne fait plus partie d’aucun tissu urbain. Elle existe, tout au plus, elle coexiste. Son sous-texte est un contexte de merde ». Rem Koolhaas, Bruce Mau et Hans Werlemann, S,M,L,XL, sous la dir.de Jennifer Sigler, Monacelli Press, New York, 1995, 502. ↩
-
Esin Kömez Dağlıoğlu constate qu’en 2015, peu d’écrits critiques ont été publiés sur le « débat de contexte » depuis les années 1990. Esin Kömez Dağlıoğlu, « The Context Debate: An Archaeology », Architectural Theory Review 20, no. 2 (2015): 266–279. Parmi les différentes publications qui visent à relancer et à actualiser une conversation sur le contextualisme, voir Tom Avermaete, Véronique Patteeuw, Léa-Catherine Szacka et Hans Teerds, dir., OASE 103, Critical Regionalism Revisited (2019); et Bryony Roberts,dir., Log 48, Expanding Modes of Practice (Hiver/Printemps 2020). ↩
-
Voir Michael Hill et Peter Kohane, « Site Decorum », Architectural Theory Review 20, no. 2 (2015): 228–246. ↩
-
Robert Venturi, « Context in Architectural Composition: extraits de M.F.A. Thesis, Princeton University, 1950 » dans Complexity: Design Strategy and World View, dir. Andrea Gleiniger et Georg Vrachliotis, Birkhäuser, Bâle, 2008, 15. ↩
-
Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture Museum of Modern Art, New York, 1966. ↩
-
Alfred H. Barr, Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson, et Lewis Mumford, Modern Architecture: International Exhibition, New York, Feb. 10 to March 23, 1932, Museum of Modern Art, Museum of Modern Art, New York, 1932, catalogue d’exposition. ↩
-
David Harvey considère le tragique maelstrom de la « destruction créatrice » et de la « création destructrice » comme inhérente au projet des Lumières, du Faust de Goethe à Mao. « On ne peut tout simplement pas faire d’omelette sans casser des œufs », argumente-t-il. Il ne s’agit toutefois que d’une vision partielle, bien que dominante, du mouvement moderniste. Comme le remarque l’historienne de l’architecture Sandy Isenstadt, « le modernisme n’a pas été à l’abri d’une réflexion sur le contexte », puisque, par exemple, les architectes européens ont toujours considéré leurs centres historiques comme sacro-saints et, en fait, comme le suggère Harvey, « le mépris du tissu existant » remonte bien avant même l’haussmannisation du XIXe siècle. C’est néanmoins, comme le postulent Harvey et Andreas Huyssen, la vision du modernisme que de nombreux postmodernistes s’efforcent d’opposer dans leurs travaux. Voir David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Cambridge, MA & Oxford, 1990, 16; Isenstadt, « Contested Context », 161; et Andreas Huyssen, « Mapping the Postmodern », New German Critique 33, Modernity and Postmodernity (Automne 1984): 5–52. ↩
-
Denise Scott Brown, « Context and Complexity », dans Complexity, Gleiniger et Vrachliotis, 24–34. L’article s’inspire d’un essai antérieur paru dans le Lotus susmentionné, « Talking about Context », Lotus 74 (Novembre 1992): 125-128. ↩
-
Pour en savoir plus sur la mythologie de l’héroïsme dans la modernité, voir Harvey, The Condition of Postmodernity, 20–33. ↩
-
Harvey, The Condition of Postmodernity, 36. Cette dernière phrase est citée par Harvey, extraite de Andreas Huyssen, « Mapping the Postmodern », 14. ↩
-
Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York, 1961. ↩
-
Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Museum of Modern Art, New York, 1964, catalogue d’exposition. ↩
-
Robert Venturi, Denise Scott Brown, et Steven Izenour, 1972, Learning from Las Vegas: The Forgotten Symbolism of Architectural Form, éd.rev., MIT Press, Cambridge, MA & London, 1977, xvii. ↩
-
Colin Rowe et Fred Koetter, Collage City, MIT Press, Cambridge, MA & London, 1978, 49. ↩
-
Ernesto N. Rogers, « Continuità », Casabella Continuità 199 (1953–1954): I. Au début de son mandat, Rogers a élargi le titre du magazine à Casabella Continuità. ↩
-
Aldo Rossi, The Architecture of the City, trad. Diane Ghirardo et Joan Ockman, Oppositions Books, MIT Press, Cambridge, MA & London, 1982, 103. ↩
-
Voir Esin Kömez Dağlıoğlu, « Reclaiming Context: Architectural Theory, Pedagogy and Practice since 1950 » (Thèse de doctorat, TU Delft, 2017). ↩
-
Kömez Dağlıoğlu, « Reclaiming Context », 27. Voir aussi Léa-Catherine Szacka, Exhibiting the Postmodern: The 1980 Venice Architecture, Biennale Rizzoli, New York, 2016. ↩
-
Voir Marine Urbain, « The Critical Construction of Critical Regionalism », OASE 103, Critical Regionalism Revisited (2019): 43. ↩
-
Kenneth Frampton, « Toward a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance », dans The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, dir. Hal Foster, Bay Press, Seattle, 1983, 16–30. ↩
-
Voir Peter Eisenman, « The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End », Perspecta 21 (1984): 154–173. ↩
-
K. Michael Hays, « Critical Architecture: Between Culture and Form », Perspecta 21 (1984): 16–17. ↩
-
Mark Wigley et Philip Johnson, Deconstructivist Architecture Museum of Modern Art, New York, 1988, 17, catalogue d’exposition. ↩
-
George Baird, « ‘Criticality’ and Its Discontents », Harvard Design Magazine 21, Rising Ambitions, Expanding Terrain (Automne/Hiver 2004): 16–21; et, pour l’articulation la plus connue de la post-criticalité, Robert Somol et Sarah Whiting, « Notes Around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism », Perspecta 33, Mining Autonomy (2002), 72-77 ↩
-
Rem Koolhaas, cité dans Beth Kapusta, The Canadian Architect Magazine 39 (Août 1994): 10; à son tour cité dans Baird, « ‘Criticality’ and Its Discontents », 18. ↩
-
Kömez Dağlıoğlu, « The Context Debate », 268. ↩
-
Bryony Roberts, « Expanding Modes of Practice », Log 48, Expanding Modes of Practice (Hiver/Printemps 2020): 12. ↩
Je remercie en particulier Irene Chin et Jann Wiegand pour leur aide dans la recherche et aussi Jann pour le titre.